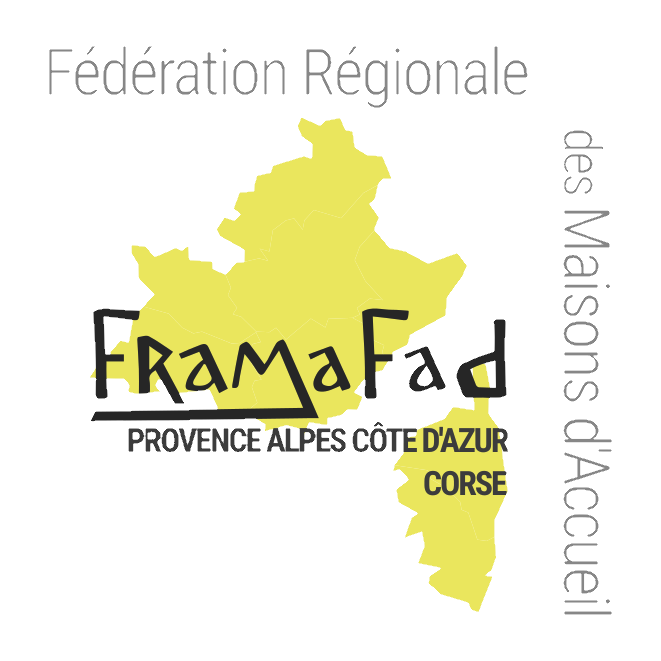« LA MENACE terroriste issue du milieu carcéral constitue un immense défi, qui sera de plus en plus important pour la sécurité nationale. Le nombre d’islamistes condamnés est en augmentation et leur sortie sera de plus en plus nombreuse » : à l’occasion de l’installation de Céline Berthon à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, Gérald Darmanin a insisté mardi sur l’enjeu crucial du suivi des sortants de prison.
Le grand défi de la surveillance des radicalisés sortis de prison
— framafad paca corse (@WaechterJp) January 11, 2024
« LA MENACE terroriste issue du milieu carcéral constitue un immense défi, qui sera de plus en plus important pour la sécurité nationale. Enquête du @Le_Figaro pic.twitter.com/rHTjyYB600
• Christophe Cornevin
L’attentat perpétré le 2 décembre près du pont Bir-Hakeim par Armand Rajabpour-Miyandoab, terroriste d’origine iranienne âgé de 26 ans et condamné à cinq ans de détention en 2018 pour divers projets d’attentats, avait jeté une lumière crue sur ce sujet brûlant, qui vire au casse-tête. Le sujet est d’autant plus épineux que 70 détenus écroués pour des crimes terroristes vont être libérés de prison dans les deux prochaines années. Plus précisément, 36 sorties sont programmées cette année et 34 autres en 2025. À 200 jours des Jeux olympiques de Paris, les services spécialisés tentent de resserrer encore les mailles d’un filet qui n’a cessé de se tendre. Selon un dernier bilan, l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) a recensé depuis juillet 2018 la remise en liberté de quelque 486 terroristes islamistes (TIS), dont 84 femmes. « Il s’agit du point de vigilance principal, majeur pour nous tous et en particulier pour la DGSI, qui surveille ce phénomène », a affirmé l’hôte de Beauvau devant un parterre de cadres de la sécurité.
« Il n’y a aucun sortant qui se retrouve dans la nature sans surveillance », assurait-on le mois dernier au ministère de l’Intérieur, qui tient à jour des tableaux confidentiels : en face de chaque nom d’islamiste est inscrit un service de renseignement, chargé - et donc responsable - de le suivre à la trace. Dans l’écrasante majorité des cas (plus de 90 %), les condamnés dans des affaires de terrorisme, c’est-à-dire les plus venimeux, sont pris en charge par la DGSI tandis que les agents de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT) et de la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) ciblent les radicalisés qui avaient été incarcérés pour des affaires de droit commun. En vertu d’un « principe de continuité », les policiers antiterroristes partagent avec leurs homologues du Service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) une « note d’incarcération » détaillant le profil du terroriste qui entre puis sort de cellule.
« Pour limiter les risques de récidive, les services répressifs disposent de deux leviers », rappelle un préfet. Sur le plan judiciaire, figure notamment l’obligation de participer au dispositif Pairs (Programme d’accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale), qui impose aux islamistes sortis de prison trois à vingt heures d’entretiens par semaine pour mesurer leur « désengagement religieux » et leurs possibilités de réinsertion. « Depuis juillet 2021, l’arsenal judiciaire a été renforcé par des mesures de sûreté post-peine qui permettent au juge, après évaluation, d’allonger le suivi du radicalisé jusqu’à cinq ans après sa sortie de prison », se félicite-t-on de même source. Sur le plan administratif, le maillage s’est aussi renforcé. En petit comité, le ministère de l’Intérieur a révélé début décembre avoir mis en place, depuis 2017, pas moins de 787 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas). « 80 % d’entre elles ont été prises dès la sortie de prison des islamistes », souffle un fonctionnaire de haut rang qui précise que ces garde-fous sont en théorie censés « interdire les liens avec la sphère islamiste », « limiter les déplacements à la commune » pour faciliter les surveillances et « imposer un pointage en commissariat ou en brigade, jusqu’à une fois par jour pour les cas les plus dangereux ». « Le seul problème d’une Micas, c’est qu’elle n’est valable que pour une période d’un an », grince un connaisseur du dossier. C’est pour cette raison que le gouvernement, en 2021, avait essayé de porter son extension à deux ans avant que le Conseil constitutionnel ne censure cette initiative.
Aux aguets, les services de renseignements musclent la riposte sur le terrain. En plus des surveillances physiques - une dizaine d’agents doivent se relayer pour suivre une cible H 24 - et le suivi des réseaux, les agents font appel à des moyens de plus en plus sophistiqués. Ainsi, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a révélé en juin dernier que la lutte antiterroriste a nécessité en 2022 plus de 30 000 demandes d’espionnage informatique, de géolocalisation en temps réels ou encore d’interceptions téléphoniques. Le tout pour surveiller 6 500 suspects, classés sur une échelle dangerosité allant de 1 (pour les profils plus menaçants) à 3 (censés être moins nocifs).
« À chaque violation des mesures de contrôles, les sanctions tombent », soufflait en décembre une source autorisée, citant le cas de Karim A., un « velléitaire » condamné à 6 ans pour avoir voulu rejoindre l’État islamique en Syrie, sorti de prison en 2023 et interpellé le 17 octobre dernier après un signalement de la DGSI qui avait détecté la diffusion de propos apologétiques. « L’examen de son ordinateur a permis de confirmer les soupçons : le 16 novembre dernier, il a été condamné par le tribunal de Bobigny à 6 ans de prison, avec une peine de sûreté des deux tiers », siffle-t-on de même source. C’est aussi pour avoir glorifié le djihad à sa sortie de prison qu’Abdulhamid A., un réfugié syrien arrivé en France en 2016, a quant à lui été interpellé en octobre à Dax (Landes) avant d’écoper de 5 ans d’emprisonnement et d’une mesure d’expulsion assortie de 10 ans d’interdiction du territoire. « Depuis août dernier, neuf sortants de prison, parmi lesquels un Somalien, trois Algériens et deux Franco-Turcs ont été éloignés », a-t-on détaillé Place Beauvau.
À force de travailler sur des procédures très documentées, les analystes de la DGSI ont établi une typologie répartissant les sortants islamistes en trois catégories. « Dans un peu plus de 60 % des cas, ils sont considérés comme désengagés, c’est-à-dire en rupture avec l’idéologie djihadiste », a expliqué un cadre du renseignement, ajoutant qu’il « s’agit de velléitaires qui voulaient partir dès 2012 ou 2013 sur zone et dont l’activité ne soulève a priori plus d’inquiétude depuis leur sortie de prison ». Les 40 % restants présentent des profils « prosélytes et violents », toujours ancrés dans l’idéologie radicale et ayant un profil de « leaders charismatiques » en raison de l’aura dont ils ont bénéficié derrière les barreaux. S’y trouvent aussi le groupe des « ambivalents », sur lesquels les services n’ont pas assez d’éléments pour considérer qu’ils sont « désengagés ». Ce sont eux qui peuvent dévisser à tout instant, à l’instar du tueur radicalisé Armand Rajabpour-Miyandoab, sorti de prison il y a trois ans avec des alertes psychiatriques qui n’ont pas été signalés, jusqu’à ce qu’il ne sème la mort non loin de la tour Eiffel. Véritable angle mort, le suivi de ceux que les experts de l’antiterrorisme ont longtemps nommés les terroristes « hybrides », tuant au nom d’Allah et présentant de graves troubles mentaux. Aujourd’hui, ces vrais « fous de dieu » représentent 20 % des 5 200 radicalisés faisant l’objet d’un suivi actif au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). « Sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur, les services de renseignements ont renforcé leurs liens avec les professionnels de santé et le milieu de la psychiatrie », insiste un proche du dossier.
Alors que les praticiens donnent leur avis, sous le couvert du secret médical, lors de groupes d’évaluation départementaux qui suivent au cas par cas les islamistes potentiels, sous l’autorité des préfets, la DGSI s’est adjoint les services de deux médecins psychiatres qui aident les enquêteurs à mettre des mots sur ce qui relève de problèmes psychologiques ou d’une vraie pathologie mentale. « Ils permettent aussi de mieux aiguiller des dossiers vers des filières médicales », souffle un responsable policier qui garde en mémoire ce séminaire organisé en 2022 à la DGSI, lors duquel une dizaine de praticiens sont intervenus devant une centaine d’enquêteurs venant de plusieurs services. Pour réduire encore la marge de risques, le ministère de l’Intérieur planche sur un projet visant à contraindre un suspect radicalisé à consulter un médecin en cas de doute sur son équilibre mental.
Plus que jamais, cette inlassable bataille menée par le ministère de l’Intérieur pour combler les trous dans la raquette s’avère impérieuse. Elle l’est d’autant plus que, selon un décompte datant de décembre dernier, les geôles françaises abritaient encore 319 détenus (TIS) écroués pour des faits terroristes et 462 détenus de droit commun (trafiquants, voleurs, délinquants sexuels etc.) qui présentent des profils de radicalisés avant même d’entrer en prison. Parmi eux figurent sans nul doute des bombes ambulantes qui n’ont qu’un seul dessein : faire à nouveau couler le sang une fois leur liberté retrouvée, au nom de leur idéologie mortifère dont la seule issue est la mort. C. C.
Le Figaro - le 10 janvier 2024